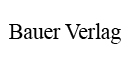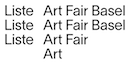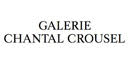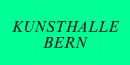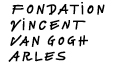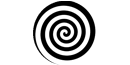Préface
Les articles de ce numéro, coédité par Felix Bernstein et moi-même, mettent en évidence de nouveaux modes de textualité à l’œuvre. Si, dans les années 1980, les signifiants ont été considérés comme totalement libérés par la force de l’atomisation sociale, ils ont également été reterritorialisés sous la forme de code digital non sémantique. À présent, texte et image sont partout, multitâches (en tant que données), et fonctionnent désormais de manière automatique et optimisée ; nous aussi. Dans ce bouillonnement actif, comment distinguer ce qui est auto- et ce qui est bio- ? Quelles méthodes critiques émergent pour l’écriture et pour la création artistique ? Les contributeur·ices de May n° 23 empruntent des voies diverses : poésie, parole, psychanalyse, synesthésie, navigation des voies neuronales et marche dans la ville.
La peinture d’Ed Ruscha de 1962 OOF, agrandie, en surplomb de l’intersection de Houston et d’Essex Street à l’automne 2023, semblait prendre part à la conversation que Felix et moi avions récemment entamée au sujet de la textualité et de l’opérationnalité omniprésente du texte comme image. Transformée en campagne marketing pour la rétrospective Ruscha au MoMA, OOF s’était retrouvée à vivre quelque chose qui semblait inévitable : une peinture recrutée comme publicité, le signe linguistique élevé à sa forme réifiée, tous les deux à la fois art et langage, embarqués dans un paysage urbain qui parle de la domination de la marchandise. La campagne publicitaire du musée misait sur l’humour propre aux peintures pop du début des années 1960 et sur sa gestalt consciente d’elle-même, qui maintenant se lit comme un mème. Mais face aux réalités tordues et dures du monde d’aujourd’hui, ce que l’on ressent avec OOF est devenu anecdotique, désuet, de l’ordre d’une confortable lassitude. Comme panneau d’affichage, ce fut une farce à différents niveaux. Mais en tant qu’œuvre d’art, elle m’a parlé.